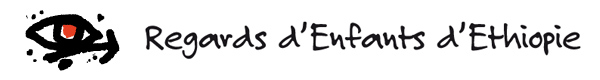J’étais de retour dans ma ville natale depuis à peu près un mois et je jouissais de l’incomparable accueil familial dont je ne me rassasie jamais.
Il faut dire que j’ai été très tôt et brusquement privée de la chaleur familiale, de l’odeur de l’encens, du parfum du café et de sa cérémonie rassurante, des chants matinaux des églises qui peuplent ma ville, des jours de fêtes et de leurs rituels, de tout ce qui fût, en fait, mien jusqu’à mon adolescence.
Je sais qu’il y aura toujours un grand manque à combler puisque adolescence non plus il n’y en a pas vraiment eu. Les jeunes de mon age avaient, grâce à la révolution socialiste et à son régime militaire, sauté lestement cette étape pour devenir vite adulte et jongler avec la mort.
Je goûtais alors mon retour d’autant plus avidement, je me levais tôt le matin pour me promener dans les ruelles de ma jeunesse, regardais encore et encore chaque coin, chaque bâtisse, chaque individu qui passe. Je regardais comme on mange et comme on boit quand on a faim et soif, à satiété.
Je regardais l’herbe à mes pieds et les couleurs des oiseaux, incroyables ces couleurs, du rouge vive, du bleue, du turquoise, du vert lumière… Il y a tant de générosité dans les couleurs qui habillent les oiseaux de mon pays que j’ai soupçonné un instant les pigeons et les corbeaux de mon exil d’avoir sacrifié leur robe pour les embellir. Pensent-ils ainsi contribuer à l’équilibre du monde, à alléger les souffrances d’ici.
J’écoutais aussi les mélodies des voix, celles des radios qui courent de fenêtre à fenêtre, Telahun, Haileyé, Gigi et les autres qui pleurent ce par quoi nous nous sentons bien vivant, l’éternel amour perdu. Je souriais à la richesse des mots, aux tournures des phrases, ces coussins sur lesquels on peut se laisser tomber sans jamais se faire mal. Je m’amusais à deviner les différents accents révélateurs des origines ethniques, j’épiais les odeurs, les plaisanteries, j’essayais de percer le souvenir, rattraper le temps perdu pour m’unir à mon moi d’avant, combler le trou, terminer le puzzle, surtout ne plus être la pièce manquante.
Il n’y avait en moi aucune amertume, ni tristesse mais de la plénitude au parfum d’eucalyptus, du beurre rance et du Dama Kesse . J’arrivais à sauter par-dessus les années, c’était comme si je n’avais jamais quitté, ni passé trente ans ailleurs dans un ailleurs si différent. Ce retour comme tous mes autres retours c’était vraiment une potion. Une potion qui guérit du mal de l’exil.
En fait, pour se sentir de nul part ailleurs mais d’ici, il suffisait de mettre un Netela (voile traditionnel éthiopien) sur les épaules, un foulard sur la tête, une phrase bien lisse à la bouche, et les paupières poliment baissées réciter comme un murmure, tout doucement un poème vieux comme le temps qui parle de racine, d’identité et de la mort qui est plus douce quand elle arrive dans son chez soi et que je n’ose traduire tant j’ai peur de l’esquinter.
‘Sew be hageru
Bibela sar
Bibela mekmeko,
Yekeber yelem wey
sewenetu tawko‘
Enfin, comme je disais donc je profitais avec gourmandise et d’une manière presque indécente des joies de ce retour quand une expérience inégalée m’atteint de plein fouet.
J’avais, cet été là, prévu de mener une enquête, dans un cadre d’une recherche universitaire sur l’organisation sociale des mendiants de la ville d’Addis Abeba et je me préparais à aller affronter les douleurs et les cris au secours de cette ville tant aimée. J’allais confiante car en matière de misère, je croyais et cela depuis bien longtemps, avoir tout vu et tout connu. Ne suis-je pas la fille d’un des pays les plus pauvres du monde ? La misère, les abris de fortune en plastique et en carton, les maladies, la déchéance et le désespoir, je les ai côtoyés depuis bien longtemps. Il est vrai cependant que chaque année, chaque nouvelle aventure arrivait avec son lot de misères inédites et l’on se dit à chaque fois : ‘Je croyais avoir vu le pire, jusqu’où peut-on donc aller dans la misère? ‘Quand allons-nous enfin voir le bout ?’
Il n’y a pas de mots, ni de larmes, ni de révoltes pour exprimer ce que la capitale cache de douleur par endroit. Cela serait d’ailleurs de la trahison de révéler ce que la pudeur, la politesse, la fierté des victimes tentent de cacher derrière un sourire, derrière un semble de toit, derrière l’absence, nombreux sont ceux qui ne sortent plus ou ne parlent plus pour ne pas afficher cette misère.
Pourtant , nul ne peut s’empêcher de crier ce mal au monde, ni de chercher comme par réflexe les responsables, les coupables pour crier fort et en toute innocence : ‘A mort les tyrans !’ Sur le coup, on a même envie de les descendre (tiens pourquoi descendre et les descendre d’où ?) et user de ses griffes et de ses dents pour les mettre en pièces.
Contrairement à beaucoup de gens pourtant je n’ai jamais su qui désigner, qui pointer du doigt, qui accuser et combattre. Je me surprend simplement et à chaque fois, en train de regarder vers le haut, le pouvoir, les palais, le ciel et de poser la même et unique question : ‘Mais quelle jouissance peut-on donc tirer à régner sur un peuple en guenille, sur cette misère sans fond ?’
Je me préparais donc à mener cette enquête auprès des mendiants de la rue d’Addis Abeba, dans les quartiers de ‘Guiorguis’ et de ‘Tekur Anbessa’ et il était convenu que 12 jeunes garçons de la rue, inclus dans un projet de réinsertion sociale et scolaire m’assistent pour ce travail de terrain.
Quand je suis arrivée sur le lieu de notre rendez-vous, les jeunes s’étaient engouffrés dans le mini-bus d’un de leur bienfaiteur, le directeur de l’Ong (Godanaw), qui avait pour cette occasion accepté de nous servir de chauffeur. Ils menaient une conversation animée avec lui et ne prêtaient que vaguement attention à ce que j’essayais d’expliquer quant au déroulement de notre travail. J’ai alors fini par demander une explication et Monsieur Mulatu le directeur, m’a informé que les jeunes souhaitaient aller d’abord aider une femme en souffrance qui gît près de leur foyer. Ils disaient sans relâche : ‘Gash Mulé (diminutif affectif de Mulatu) s’il te plait, elle va mourir. Elle était bien quand elle est arrivée, elle est squelettique maintenant. Elle ne répond pas quand on lui parle, Gash Mulé s’il te plait. La pluie, le soleil elle subit tout. Amenons-la à la clinique de la Mère Thérèse. S’il te plait Gash Mulé’.
J’étais étonnée par l’intérêt que ces jeunes portaient au cas de cette femme qui même, si l’on ne veut ou l’on ne peut se l’avouer n’est pas chose rare dans la capitale. L’ardeur qu’ils mettaient à convaincre le directeur me surprenait. Etant pris en charge par une Ong qui leur vient en aide, on ne trouvait plus aucune trace de précarité sur le visage de ces jeunes. Ils ressemblaient à tous les adolescents du monde, ils avaient la beauté de leur age, les belles dents typiques des gens d’ici qui invitent constamment au sourire. On ne devait trouver chez eux que joie, insouciance et voir même un brin d’indifférence et d’insolence.
Gash Mulé finit par accepter de les suivre et nous sommes allés chercher d’abord du savon, des habits d’occasion, du plastique pour enfin nous rendre auprès de la femme.
Il y avait là une femme couchée en position du fœtus, elle paraissait grande, ses cheveux hirsutes dépassaient le plastique qui était jeté sur son corps pour la protéger de la pluie, près d’elle quelques menus pièces de monnaie et une banane en décomposition. Nous nous sommes approchés d’un pas ferme, les enfants surtout. Gash Mulé essaye de la réveiller, il lui parle, il parle de plus en plus fort en amharique puis en langue oromo (sûrement à cause de grande taille). Elle répond à peine, elle veut qu’on la laisse mourir. Gash Mulé prend les choses en mains, les enfants suivent. Il essaye de la soulever, il n’arrive pas, elle ne l’aide pas, une odeur sans nom se dégage d’elle, Gash Mulé crie l’insulte même, la traite de ‘Hateraw !’, une insulte qui n’en est pourtant pas une et qui veut plutôt dire ‘j’ai peur, je suis triste, aide moi et quel malheur ou tout à la fois’.
On demande un seau et une cruche aux voisins, les voisins hésitent puis donnent. Maintenant qu’ils ont trouvé des gens pour s’occuper de ce qui les encombre depuis des semaines ils n’aillaient pas compliquer les choses.
Déjà, les gens du quartier nous entourent et le nez bien caché par leur netela en gardant la distance qui leur permet de satisfaire leur curiosité sans pour autant directement subir l’horrible du spectacle, ils commencent à bénir ces bienfaiteurs inespérés « Egziahaber yestachehu ! Egziahber ye barkachehu ! ».
Emportée par un sincère sentiment de solidarité, je remonte les manches et je m’approche pour aider quand à la vue de ce corps qui tombe en pièce et à l’odeur qui s’y dégage, je recule brusquement pour rejoindre le camp des spectateurs. Et je reste là, figée telle une pierre à regarder les enfants qui sans dégoût et sans aucune protection commencent à laver la femme. Ils la lavent les mains nues, les gens s’exclament ‘Avec les maladies qui courent ces pauvres enfants !’. Ils lui lavent les jambes, le ventre, l’intimité de cette femme qui n’est pas leur mère ni aucune autre parente à eux . Peut être que toutes les femmes du monde sont nos mères. Ne dit-on pas de même mère patrie ? Est-ce de la misère de leur mère patrie dont ils se chargent ainsi. Ils décrassent, chassent à grand jet d’eau les parasites. Ils purifient pour sauver cette terre puisque même pour les plus démunis d’entre nous ne plus avoir une mère ou une mère patrie c’est probablement la chose la plus intolérable qui soit.
‘Enat, abat bimot be hager yelekesal
Wondem, ehat bimot be hager yilekesal
Hager ye mote endhu wodet yederesal’
Si une mère, un père meurt
On pleure dans son pays
Si une sœur, un frère meurt
On pleure dans son pays
Mais si sa terre se meurt
Là, tout est alors finit
Je ne regardais plus la femme que la misère a abandonnée à la mort au bord de la rue. Je regardais juste les longs doigts de Zelalem, de Gojé, Hénok et les autres. Ces doigts qui frottent, savonnent, plient et déplient ce corps qui n’en est plus un pendant que Gash Mulé le maintient difficilement debout. Ce dernier criait, « Seigneur ! elle est envahit de vermine !
C’est là que j’ai évalué la distance qu’en reculant j’ai crée entre les enfants et moi. J’ai pensé « Il me reste donc autant de chemin à parcourir pour m’approcher de Toi ! » . Pourquoi eux et pas moi ? J’étais triste et mes larmes ne tarissaient pas, un sentiment de ne pas avoir été choisie me serre le ventre, le même sentiment que celui qui m’habitait toute petite quand les grands enfants de la cour de récréation ne voulaient pas de moi dans leurs jeux. J’attendrai, je grandirai, vous me guiderez.
Une fois qu’ils l’ont séchée, habillée, roulée dans une grande pièce de plastique pour ne pas souiller le mini-bus, et bien calée au fond du mini bus, Gash Mulé et les jeunes se sont rejoint à nous, tout simplement, comme si de rien n’était.
Je scrutais avec angoisse le regard des jeunes. Dans leurs yeux, je ne trouvais rien de ce que je connaissais, ni tristesse, ni révolte, ni compassion, ni satisfaction du devoir accompli, aucune émotion, rien. Je me suis alors souvenu d’un livre biographique d’un journaliste de père afro-américain et de mère américaine blanche et qui se tourmentait des problèmes de race et de couleur. Enfant, il demanda un jour à sa mère « Maman quelle est la couleur de Dieu ? » Et la mère réfléchit un instant et lui donne une de ces réponses les plus inattendues «Mon fils, je crois que Dieu a la couleur de l’eau. »
Les yeux de ces enfants qui n’exprimaient rien qui me soit connu, ces mains aux longs doigts agiles qui donnaient sans compter, qui donnaient sans recevoir avaient pour moi en cet instant précis la couleur du non-couleur, la couleur de l’eau, celle de Dieu, que je rencontrais pour la première fois et j’ai été foudroyé par sa beauté. Désormais les choses ne seront plus pareilles.
Et la conversation la plus banale sur le programme du reste de la journée a repris. Moi aussi j’ai suivi, mais oui comme si de rien n’était.